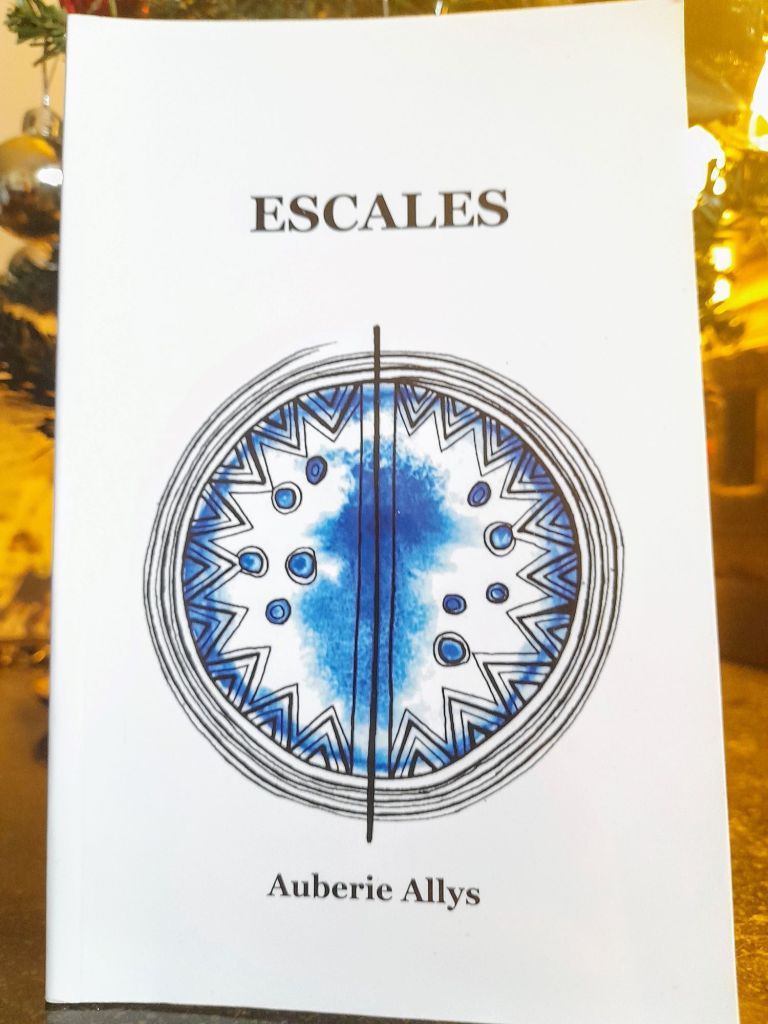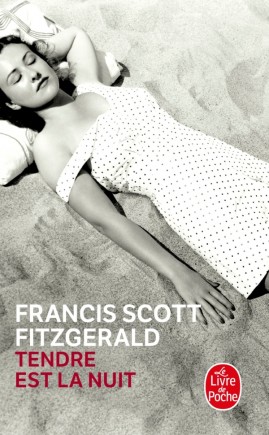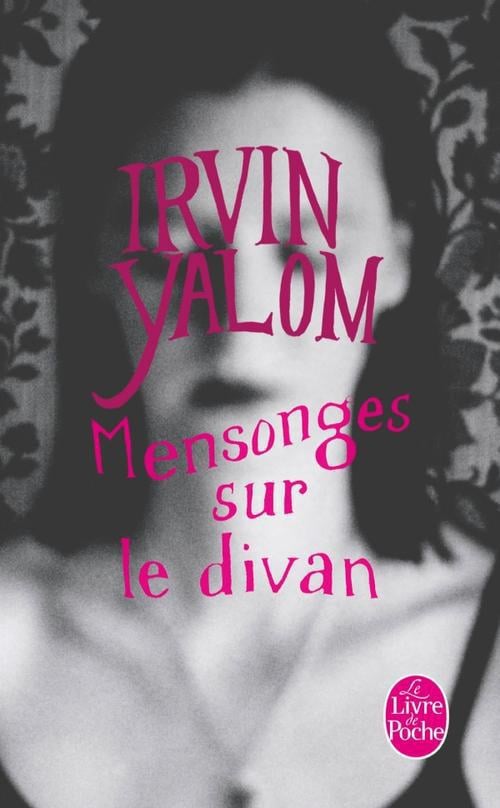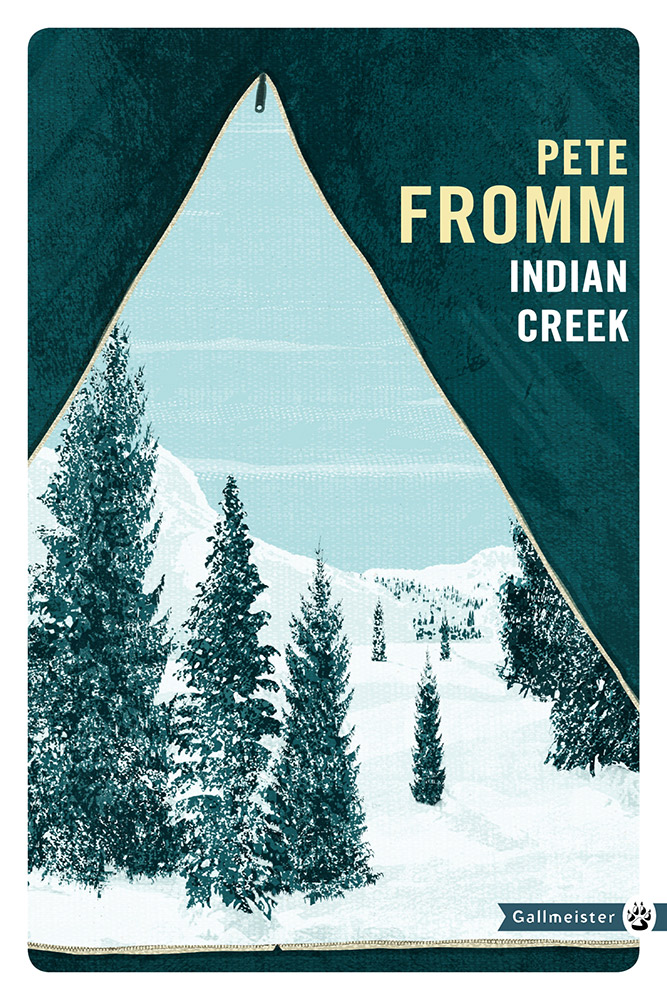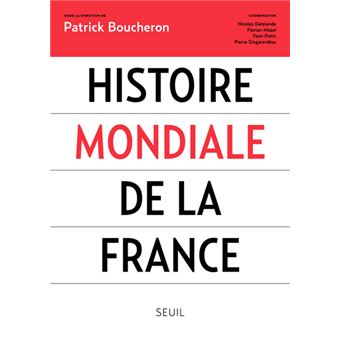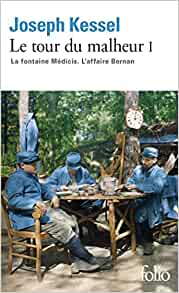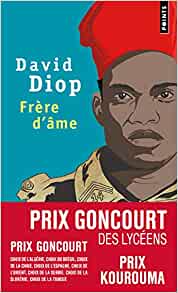Editions Gallimard 2025 – 642 pages
Je suis une fan de Chimamanda Ngozi Adichie depuis que j’ai lu Americanah. J’ai été tellement conquise par ce roman, qu’ensuite j’ai lu L’hibiscus pourpre, peut-être mon préféré et ensuite L’autre moitié du soleil. Découvrir l’univers d’une nouvelle romancière n’est pas si fréquent. Chimamanda est une conteuse. Elle donne vie à chacun de ses personnages, grâce à une foultitude de détails, avec infiniment de finesse et de profondeur. Sa puissance créatrice nous emporte dans des récits riches et amples qui parlent du monde où nous vivons.
Chimamanda est une écrivaine nigériane. Partie aux Etats-Unis pour ses études, elle y vit désormais. Ses ouvrages – romans, essais – ont reçu de multiples récompenses. Elle est docteur honoris causa de plusieurs universités dont la Sorbonne Université en 2025 et membre de l’Académie américaine des arts et des sciences. C’est également une femme engagée pour le féminisme. Elle a publié en 2020 un essai sur le féminisme intitulé « Nous sommes tous des féministes ».
Quand j’ai appris que Chimamanda venait en France pour présenter son nouveau roman L’inventaire des rêves, je me suis inscrite avec une amie à une rencontre organisée par l’Institut d’Etudes Politiques à Paris. Et j’ai pu la voir en chair et en os et l’écouter. Et j’ai acheté un exemplaire du roman, signé par elle !
L’inventaire des rêves, traduit de l’anglais (Nigéria) par Blandine Longre, raconte et entrelace les parcours de quatre femmes qui sont proches et qui essaient de construire leur vie. Chiamaka, Zikora et Omelogor diplômées et privilégiées sont nigérianes. Kadiatou est née dans un village en Guinée. Elles vivent aux Etats-Unis sauf Omelogor qui vit au Nigéria. Ces femmes se battent pour trouver leur place dans le monde et réaliser leurs rêves. L’auteure consacre un chapitre distinct à chacune des héroïnes.
Chiamaka a rencontré Kadiatou alors que celle-ci était femme de chambre dans un hôtel à Washington où ses parents séjournaient. Chamiaka a reconnu en Kadiatou une autre africaine de l’ouest, a sympathisé avec elle et lui a proposé de venir travailler chez elle. Chiamaka aide Kadiatou à s’orienter dans les arcanes de son nouveau pays, les Etats-Unis. Le personnage de Kadiatou est librement inspiré de Nafitassou Diallo, agressée sexuellement par Dominique Strauss-Kahn. Employée de maison à Conakry, Kadiatou a demandé l’asile aux Etats-Unis pour rejoindre Amadou, son amoureux, immigré aux Etats-Unis depuis plusieurs années. Amadou lui a conseillé de faire une demande d’asile en disant qu’elle avait été excisée – ce qui est vrai Kadiatou a été excisée – et qu’elle voulait éviter le même sort à sa fille. Car dit-il : « C’est ce que les Américains aiment entendre. Si tu leur dis la vérité, que tu veux une vie meilleure, ils rejetteront ta demande » ( Pages 313-314 ). Kadiatou obtient l’asile. Elle s’adapte peu à peu à la vie de son nouveau pays et apprend à en parler la langue tant bien que mal. Elle trouve un emploi de femme de chambre dans un hôtel à Washington et loue son propre appartement pour elle et sa fille. Elle a trouvé sa place aux Etats-Unis.
Quand elle est agressée sexuellement par un client de l’hôtel, la gouvernante de l’étage appelle la police sans hésiter et sans considération pour la position sociale de leur très puissant client. La suite ressemble à ce qui est arrivé à Nafitassou Diallo. Les poursuites pénales sont abandonnées. Kadiatou est accusée par la presse d’être une manipulatrice et d’avoir été l’instrument d’un complot contre le puissant et influent client français. En France, je me rappelle que la moitié des personnes qui s’exprimait sur Nafissatou Diallo et l’affaire, toutes classes sociales confondues, pensait de même. J’en déduis que dans notre pays aussi, une femme musulmane, noire, africaine, originaire d’un village guinéen, ne peut être qu’une femme soumise à l’autorité des hommes et l’instrument de leurs complots ou bien une femme perverse et intéressée. Le racisme et les préjugés sont toujours prégnants.
L’auteure a créé le personnage de Kadiatou car elle a été émue par Nafissatou Diallo. En tant que femme et africaine de l’ouest, elle a ressenti de l’empathie envers elle et été choquée par le traitement que les médias lui ont réservé. Par delà l’agression sexuelle, elle brosse le portrait d’une femme qui s’est éloignée des vieilles coutumes passéistes de son pays pour se bâtir une nouvelle vie, aux Etats-Unis.
Contrairement à Kadiatou, Chiamaka, Zikora et Omelogor sont nées dans des familles privilégiées et fortunées. Elles ont fait des études supérieures et travaillent. Zikora, avocate, Omelogor, banquière, ont réussi professionnellement voir très bien s’agissant d’Omelogor. Chiamaka a choisi une voie plus personnelle en publiant des articles sur ses voyages touristiques dans le monde « Plaisantes observations écrites d’un point de vue africain ». La diffusion de ses articles reste plutôt confidentielle. Elle peut se permettre ce choix car ses parents sont très fortunés.
Bien qu’elles soient des femmes modernes investies dans leur activité professionnelle, Chiamaka et Zikora restent des femmes sentimentales qui veulent se marier et rencontrer l’âme sœur. Prisonnières d’une image conventionnelle de la femme, leur urgence à vouloir se marier les amène à rester avec des hommes égoïstes et machistes. Et ces femmes intelligentes perdent la lucidité élémentaire pour admettre que leur compagnon ne les respecte pas et qu’elles ne doivent pas l’accepter. Omelogor qui vit au Nigéria est différente. C’est elle qui mène la danse dans ses relations avec les hommes. La fortune qu’elle a accumulée dans son activité de banquière la conforte dans son indépendance. Mais, Omelogor n’échappe pas à la pression de sa famille qui rêve encore pour elle d’une vie plus classique. Elle a 48 ans et ne peut plus avoir d’enfant. Sa tante Jane, « tantie Jane » la harcèle pour qu’elle adopte un enfant et lui dit « Omelogor, ne fait pas semblant d’aimer la vie que tu mènes. » ( Page 404 ). Omelogor est touchée. Cette phrase la blesse. Mais elle pense « … je suis émue de me tenir ainsi sur mon balcon en ce nouveau matin de la nouvelle année. Je suis la maîtresse des lieux. Sache, tantie, que je l’aime ma vie. Il m’arrive de peiner à y trouver du sens, peut-être trop souvent, mais c’est une vie bien remplie, une vie qui en outre m’appartient…Parfois ma maison est tout illuminée par les dîners et les soirées de jeux, et je réunis différents groupes d’amis qui peut-être, ne se seraient jamais rencontrés autrement…J’aurais dû répondre à tantie Jane : « Il existe toujours une autre façon de vivre, tantie, il y a d’autres façons de vivre. » Pages 406-407
J’aime beaucoup ces phrases pleines de sincérité et de tolérance. J’imagine qu’elles sont un peu un résumé de L’inventaire des rêves.
Si le féminisme et l’émancipation des femmes sont le centre du roman, l’auteure y évoque bien d’autres sujets comme le racisme et la condescendance dont sont victimes les africains en Europe et aux Etats-Unis. Pourtant, malgré le racisme, Kadiatou la guinéenne veut rester aux Etats-Unis car elle sait qu’elle y a une vie meilleure et veut que sa fille qui a maintenant la mentalité d’une américaine y fasse sa vie. Chimamanda n’épargne pas non plus le Nigéria et la corruption qui y règne ou bien les superstitions et traditions d’un autre âge qui persistent encore en Afrique. Le snobisme et la vanité des très riches nigérians sont raillés ainsi que leur arrogance avec leurs subordonnés.
En même temps, les héroïnes du roman revendiquent avec fierté leur africanité. Elles moquent la cuisine française qui leur paraît fade comparée à la cuisine de l’Afrique de l’ouest !
Pour conclure, l’auteure donne chair et vie à ses quatre héroïnes et aux personnages qui les entourent grâce à une multitude de détails qui les ancrent dans un monde que nous reconnaissons. Elle se saisit de leurs histoires pour défendre les thèmes qui lui sont chers, féminisme, racisme, africanité.
Je dois néanmoins avouer que j’ai été moins enthousiasmée par L’inventaire des rêves que par les précédents romans de Chimamanda. Même si les héroïnes échangent, se parlent, se rencontrent, leurs quatre histoires restent parallèles. Un peu comme s’il s’agissait de quatre nouvelles distinctes – comme les chapitres qui leur sont consacrés – sur quatre personnes, certes liées entre elles, mais sans aller au-delà. Il manque me semble-t-il le souffle d’une histoire où petit-à-petit les fils se nouent entre les personnages avec un cheminement entre le début et la fin. Comme je l’ai tant aimé dans Americanah, L’hibiscus pourpre et L’autre moitié du soleil. Et le roman est un peu long.
Enfin, voici un extrait du roman pour illustrer l’écriture de Chimamanda et la richesse de son expression. Il n’y est pas question que de féminisme et de racisme ! Il s’agit d’un extrait où le père de Kadiatou, mineur dans une mine d’or, raconte des histoires pendant les veillées familiales :
« De ses longs bras minces il soulevait les petits garçons et les lançait haut dans les airs avant de les rattraper et de les faire tournoyer, leurs rires résonnant alentour. Il dînait pendant que tous les enfants l’observaient et attendaient les histoires qui suivaient son repas…Mama s’affairait à côté, décortiquant des arachides et lui faisant remarquer qu’il se trompait sur tel et tel détail, que de toute manière ce n’était pas aux hommes de raconter des histoires, et qu’un autre passage était faux, et il lui disait de raconter l’histoire elle-même et elle répliquait qu’il valait mieux qu’il continue puisqu’il avait commencé, et ensuite, ils riaient. A la lueur tremblante de la lampe à pétrole, une chaleur enveloppante et apaisante les encerclaient tous. Il racontait des histoires de vaches, de hyènes et de serpents magiques, de vampires qui se transformaient en lucioles, et comment le monde était né d’une goutte de lait gigantesque. Papa grimaçait, modifiait sa voix, faisait des gestes et tapait des mains. Parfois, il étirait tellement ses mots, comme le babillage d’un petit enfant que tout le monde éclatait de rire avant la fin de l’histoire. Kadiatou, assise contre le mur, regardait les pieds de Papa dans ses babouches, si fermement plantés dans le sol. Ses petits pieds à elle, ressemblaient exactement aux siens, plats sans cambrure ». Pages 258-259.
Je reste une fan de Chimamanda !